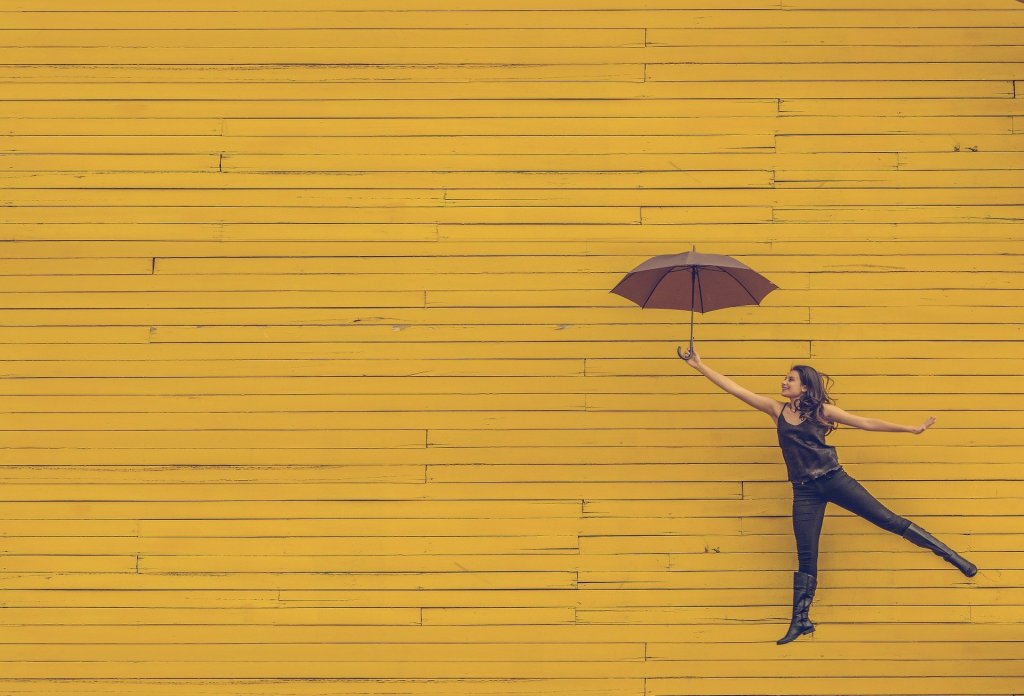
Alors qu’en Suisse nous sommes entrés depuis lundi dans une nouvelle phase de semi-confinement, j’ai été amené à m’interroger sur la notion de « commerces non-essentiels ». En effet, seuls les commerces jugés comme tels doivent fermer. Le débat fait bien sûr rage autour de la question de savoir ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas. Les fleuristes peuvent continuer à exercer, pas les libraires, par exemple.
J’avais lu sur Twitter quelqu’un qui disait comprendre à quel point il peut être difficile pour un commerçant de s’entendre dire que son commerce est non-essentiel. Ce peut être le projet de toute une vie, c’est dur voire inacceptable de l’entendre.
J’avoue avoir pour ma part une vision certes empathique mais aussi pragmatique. Sans doute que mon expérience dans la durabilité couplée à mon approche relativement minimaliste de la vie me font adopter cette position. Selon moi, il existe bel et bien des commerces non-essentiels. J’ai toujours en tête une enseigne se trouvant sur le chemin me menant de la gare à mon bureau: on y trouve principalement trois produits. Des trottinettes, des cigarettes électroniques, et des hand-spinners…Je ne pense pas que la fermeture de ce magasin rendra la population genevoise malheureuse.
Attention, je dis bien qu’il existe des commerces non-essentiels, mais aussi que les personnes y travaillant sont, elles, absolument essentielles. L’Etat se doit de les prendre en charge.
Ce qui m’amène à m’interroger aujourd’hui, c’est la difficulté que nous avons à nous mettre d’accord sur ce qui est essentiel ou non. Je le disais en introduction, les fleuristes peuvent continuer leur activité. J’en suis d’ailleurs ravi: c’est la reconnaissance que nous avons essentiellement besoin d’amener du beau, de la couleur dans nos habitats, mais aussi que les plantes, par leur présence contribuent à notre bien-être. Par contre, les librairies sont fermées. Lire un bon livre ne serait pas essentiel?! J’en doute fortement. Mais je reconnais aussi que c’est subjectif.
Hiérarchiser les besoins, Maslow l’a fait il y a bien longtemps. Et il faut dire que lorsque l’on débat de l’importance des fleuristes face à celle des libraires, l’on se trouve dans le haut de sa pyramide. Des problèmes de riches, des first-world problems. Mais malgré l’ancienneté de ces théories, on ne s’en sort pas.
Mon intuition est qu’il nous manque une mesure, un indicateur de ce qui nous rend vraiment heureux, de ce qui nous rend vraiment humains. De nombreux débats ont déjà été menés sur le non-sens qu’est le PIB comme mesure de la bien-portance d’un Etat, et le bonheur national brut du Bhoutan a été cité en exemple maintes et maintes fois.
Mais justement, au regard de notre situation, ne serait-ce pas le bon moment de relancer ce débat? Etablir, dans les grandes lignes du moins, ce qui contribue au bien-être national/régional/global? Avoir une théorie générale du bien-être, et appuyer dessus les décisions politiques y compris et surtout en temps de crise. Ce serait un choix fort. Un choix sans doute critiqué car il voudrait faire de quelque chose de subjectif – le bien-être – une base objective de décision. Mais nous devons avancer, en tant que communauté, et profiter de cette crise pour reconstruire de nouvelles bases. Bien au-delà d’un indicateur, c’est un concept de bien-être qu’il nous manque. A nous de le définir, dès à présent!
Intéressante réflexion. Toujours un plaisir de lire tes billets!
Merci Marion ! Un plaisir tout aussi grand de te lire dans les commentaires !
Pingback: Bien-être – Croissance – Partie I | Responsabilité sociale